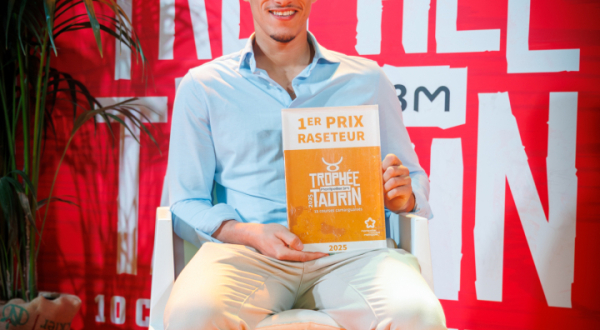Peu de cités peuvent se glorifier de connaître l’instant exact de leur naissance, mais Montpellier détient ce privilège. Son histoire prend racine au 26 novembre de l’an 985, lorsque le comte Bernard de Melgueil (aujourd’hui Mauguio), décide d’octroyer à un certain Guilhem un vaste domaine agricole. Ce geste fondateur est solennellement scellé. Le texte de l’acte témoigne de cet instant :
« Au nom du Seigneur, moi, Bernard, comte, et Sénégonde, ma femme, offrons à Guilhem cette terre fertile, où croissent les vignes et se dressent les chênes. Nous lui cédons ces lieux pour qu’il les fasse prospérer, qu’il en soit le maître aujourd’hui et pour les générations futures. »
Ce document, aujourd’hui soigneusement conservé aux Archives municipales, représente le premier témoignage écrit de l’existence de Montpellier.
Les premiers temps de la seigneurie
Ainsi naquit Montpellier, ou Montepestelario comme la nommait-on alors. Mais que représentaient ces terres à l’aube de leur histoire ? De vastes étendues sauvages, bordées de champs et de garrigues, peuplées d’arbres fruitiers et de vignes. À cette époque, un habitant est mentionné : Amalbert, un serf, dont seul le nom a traversé les siècles. Il est le premier montpelliérain connu.
Le destin de cette ville naissante repose sur les épaules de Guilhem. Ce chevalier franc, fidèle du comte Bernard, devient son vassal et pose les fondations d’une lignée sur ces terres vierges.
Une ville en construction
Au fil du XIe siècle, la ville en devenir attire des colons cherchant protection. Montpellier commence à prendre forme. La vie s’organise autour de deux bourgs distincts, perchés sur leurs collines respectives : Montpellier et Montpelliéret, séparés par une enceinte, située non loin du Verdanson à hauteur de l’actuelle rue du Faubourg-de-Nîmes, avant de remonter par la rue du Pila-Saint-Gély.
Montpelliéret, plus rural, est théoriquement sous la domination de l’évêque de Maguelone. L’église Saint-Denis, fondée à cet endroit, deviendra bien plus tard le site du Corum.
Montpellier au XIe siècle
À la mort de Guilhem IV, vers 1077, la ville n’est encore qu’un agglomérat hétéroclite d’humbles masures de bois et de ruelles boueuses où se côtoient porcs et chèvres. Les marchés se concentrent autour de l’actuelle place Jean-Jaurès, où poissonniers, bouchers et marchands d’herbes échangent leurs produits.
Deux églises, Saint-Firmin et Sainte-Marie, marquent les premiers foyers du développement urbain naissant. Cette dernière, située près de l’actuelle place Jean-Jaurès, deviendra Notre-Dame-des-Tables. Le château des seigneurs, une forteresse primitive, domine alors la ville depuis ses tours, à l’intersection des actuelles rues de l’Aiguillerie et de la Carbonnerie.
Le prix de la protection
Les seigneurs tirent profit des richesses de la campagne environnante. Ils permettent aux familles de s’y établir en échange du cens, un impôt foncier. Ils prélèvent une taxe sur chaque récolte, chaque sac de blé ou de farine. Les moulins et les fours, indispensables à la vie quotidienne, sont sous leur autorité, et les habitants doivent s’acquitter de frais pour les utiliser. De plus, le passage sous les remparts est soumis à un droit de péage.

Les seigneurs chefs de guerre
En retour, les Guilhem assurent la sécurité de leurs sujets. Ces chefs de guerre surveillent l’horizon, font construire des enceintes pour protéger la ville, organisent des gardes et veillent à ce que leurs soldats aient un toit et une ration de nourriture.
Guilhem IV a reçu le serment de fidélité des châtelains du Pouget, une preuve du prestige qu’il a acquis et de ses moyens militaires pour garantir la sécurité de terres situées à une trentaine de kilomètres.
À l’aube du XIIe siècle, les descendants du premier Guilhem ont su solidifier une simple donation en une seigneurie solide, prête à prendre son envol.